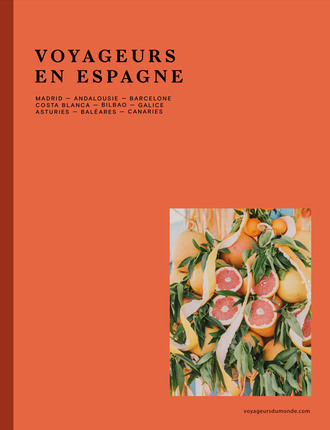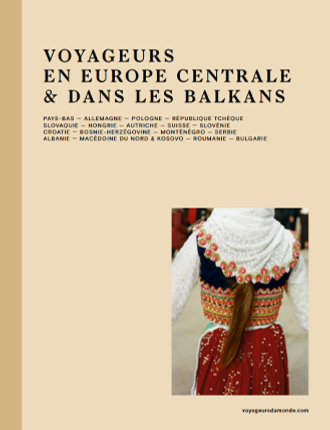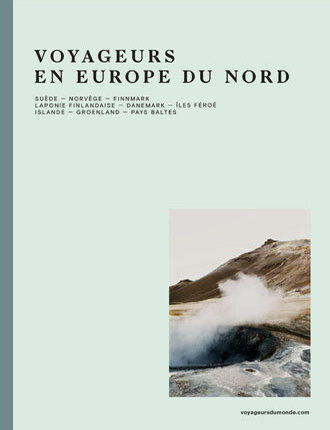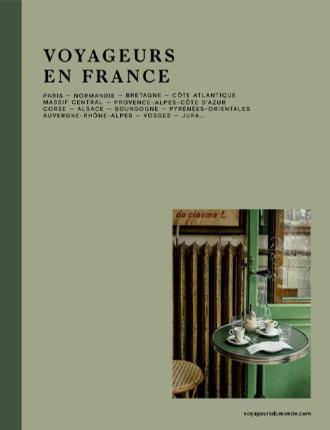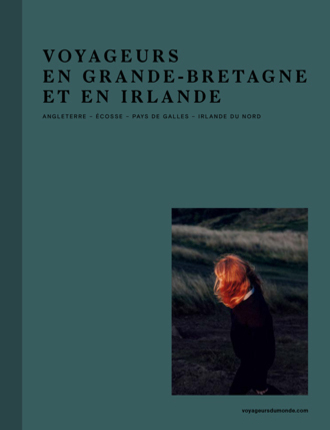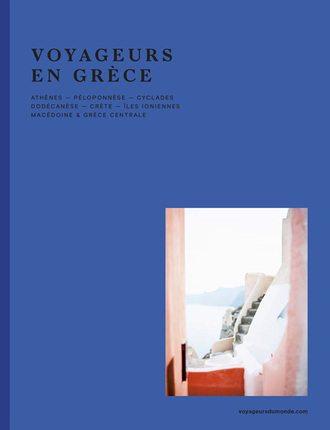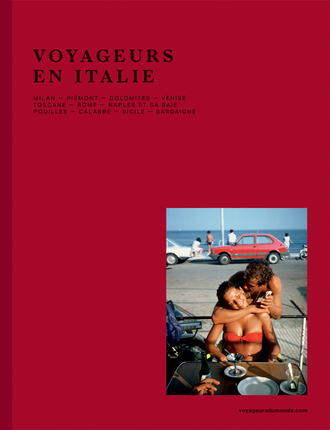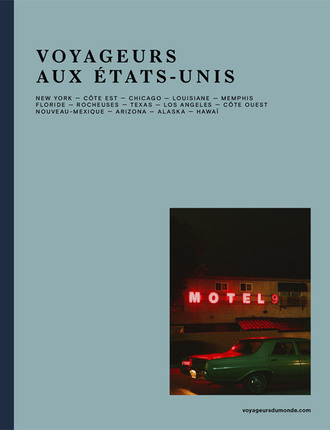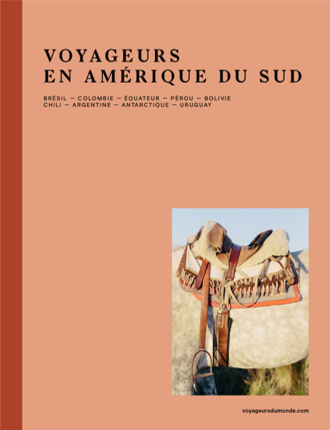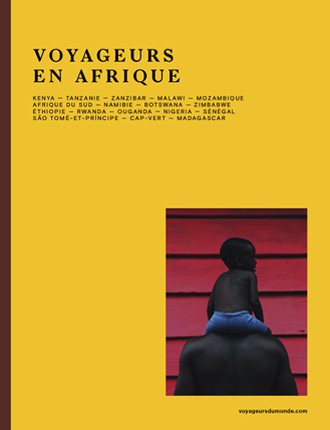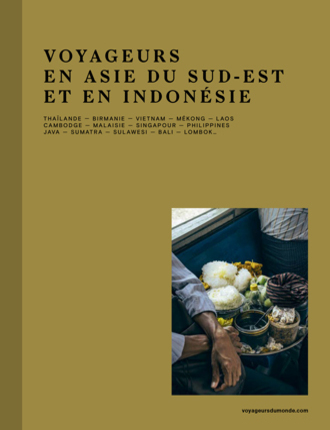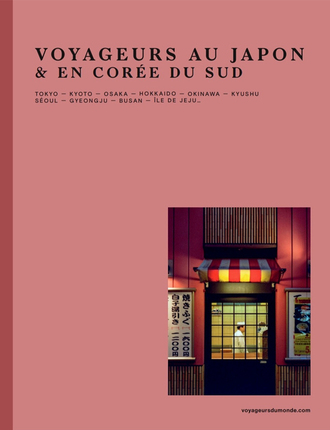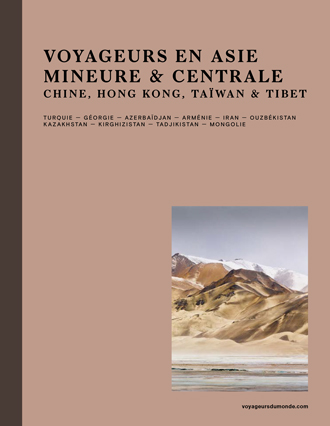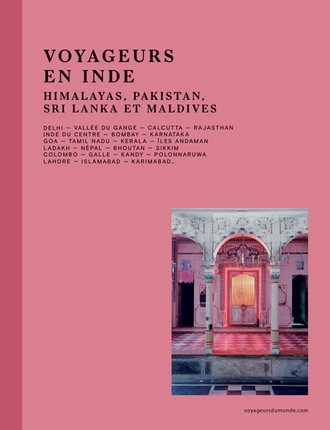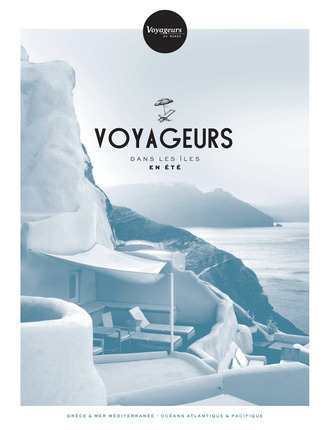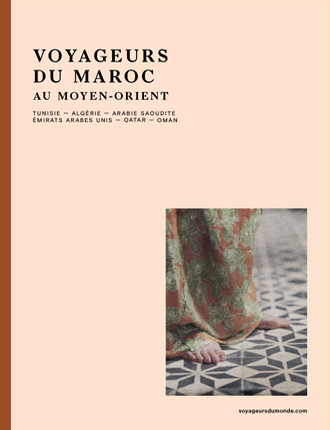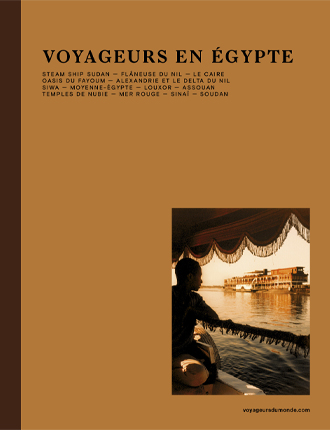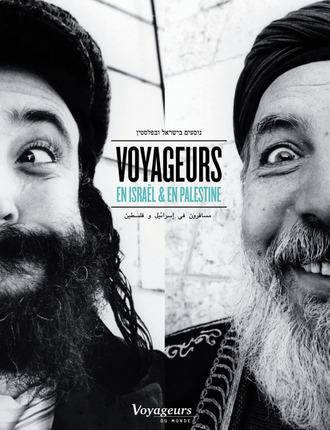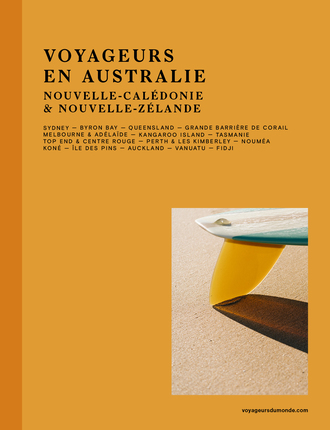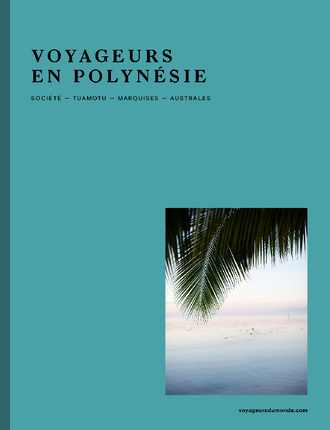Population
56 876, en 2025.
Langue officielle
Le groenlandais de droit ; le danois de fait.
Langues parlées
Près de 90% des Groenlandais ont l’inuktitut pour langue maternelle. C’est une langue eskimo. Dans sa version Groenland occidental, on l’appelle kalaallisut. Par effet démographique, ce groenlandais occidental est le groenlandais standard. Les idiomes de Thulé et de Tunu demeurent locaux ; l’enseignement en kalaallisut les menace d’ailleurs dans leurs particularités. Les locuteurs exclusifs du danois sont autour de 8%. Les relations institutionnelles avec le Danemark donnent à cette langue une certaine importance, sans cependant qu’une pratique étendue en résulte. On estime autour de 15% de la population les danophones sérieux. D’aucuns estiment que le poids du danois est encore trop important au regard des évolutions. Parmi celles-ci, l’internationalisation de l’anglais ; lequel semble, quitte à apprendre une autre langue, plus avantageux que le danois.
Peuples
La population est homogène, inuite très majoritairement. Les Inuits – le terme signifie gens en inuktitut – sont un peuple autochtone des régions polaires, originaire de Sibérie. À ce titre et dans le sens de leur migration, ceux du Groenland sont les plus orientaux des Inuits. Les Danois vont et viennent, mais ont fourni moins de résidents ces dernières décennies. L’économie a suscité une nouvelle immigration. En 2024, plus de 1800 personnes présentes sur place n’étaient pas citoyens danois. Elles viennent des Philippines, de Thaïlande, d’Islande, de Chine, de Pologne. Cela sans compter les personnels de la base militaire US de Thulé.
Religions
Lorsque les Thuléens shamanistes parviennent au Groenland, une petite chrétienté viking est installée dans le sud, Gardhar. Le premier épiscope a débarqué en 1126. L’établissement tient jusqu’à la fin du XIVe siècle, puis il se perd. Les missionnaires luthériens en retrouvent les vestiges quatre cents ans plus tard. Ce sont eux qui entreprennent la christianisation des Inuits. Lesquels, par l’intermédiaire de leurs shamans – angakkut – cherchent alors à peigner Sassuma Arnaa, déesse-sirène dont la chevelure influe sur l’état de la mer. Aujourd’hui, les shamans ne circulent plus entre les mondes et 85% des Groenlandais seraient membres de l’église luthérienne du Groenland, diocèse de la Folkekirken danoise. Les églises évangéliques gagnent en influence via Internet. Une paroisse catholique (qui relève du diocèse de Copenhague) rassemble des membres du personnel de la base de Thulé, des Danois, des Philippins. Quant au néo-shamanisme, il s’adresse à des étrangers, répondant à un certain penchant pour l’exotisme spirituel.
Fête nationale
21 juin : solstice d’été.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
6 janvier : Épiphanie.
Mars ou avril : Pâques (du jeudi saint au lundi).
4e vendredi après Pâques : jour des prières.
40 jours après Pâques : Ascension.
7e dimanche après Pâques : Pentecôte.
21 juin : fête nationale.
24, 25 et 26 décembre : fêtes de Noël.
Politique
Le Groenland est une province – depuis 1953 – autonome – depuis 1979 – du Royaume de Danemark. Ce statut d’autonomie lui donne comme tel accès au Conseil nordique. Et le maintient à la marge de l’Union européenne car, si le Danemark en est membre, ce n’est pas le cas de l’île (qui n’est pas intégrée non plus à l’espace Schengen). Copenhague accorde donc une certaine liberté au Groenland, qui se gouverne pour ce qui est fiscal et minier. La politique étrangère est à deux niveaux ; ce qui est proprement groenlandais est du ressort de Nuuk. Défense, sécurité, justice sont placées sous la direction du royaume. Le roi du Danemark étant chef de l’État (représenté sur place par un haut-commissaire), le chef du gouvernement, Naalakkersuisut, détient le pouvoir exécutif local. Il est issu de la majorité parlementaire. Le Parlement, Inatsisartut, est monocaméral, à 31 membres élus pour 4 ans à la proportionnelle. Outre cela deux députés sont élus pour siéger au parlement danois.
Histoire
Des groupes humains, d’abord paléo-eskimos, passent du Grand Nord canadien au Groenland. Un nombre variable d’individus, dans des conditions éprouvantes. Cela dure un temps, puis c’est englouti. Plusieurs fois. Ainsi va l’histoire du Groenland ancien. Pour autant que l’archéologie puisse en juger, elle commence vers 2500 avant notre ère, avec la culture de Saqqaq. On construit déjà des maisons. Tout au nord, il y a la culture Indépendance I, qui vit sous la tente et chasse le bœuf musqué. Ces gens disparaissent vers 1700 avant notre ère. Vers 1000, on repère ce qu’on nomme Indépendance II. Habitat identique, mais outils plus performants. Adaptation et technologie microlithique avancée permettent de durer jusque vers l’ère chrétienne. Indépendance II signe la fin de la culture de Saqqaq. Cependant, entre 800 avant et 300 après J.-C. dans un premier temps, la culture de Dorset, montre une habileté artistique jusqu’alors inconnue. On sculpte masques et figurines en os et en ivoire. Par ailleurs, on semble posséder un calendrier de chasse solide. Il y a une seconde phase Dorset entre les VIIIe et XVe siècles. Sans doute les établissements Dorset ont-ils été absorbés, évincés, éliminés – on ne sait trop – par les Thuléens, arrivés dans le courant du XIVe siècle.
Ces Thuléens, dont l’histoire commence aussi en Sibérie, qui ont traversé le Haut-Arctique canadien en oumiak, rechapant une culture originale, ont des liens très serrés avec les Inuits actuels. Avec eux, l’époque des Paléo-Eskimos prend fin. Ce sont des chasseurs de baleine mais pas que. Ils utilisent déjà l’ulu, le couteau groenlandais, d’ardoise alors. Et vivent en villages assez faciles à transférer. Les conditions leur permettent une sédentarité légère. Igloo l’hiver ; maisons d’os de baleine et de peau l’été. Le matériel s’améliore. Le traîneau notamment. Ils entretiennent des contacts avec les équipages baleiniers basques ou écossais. D’ailleurs, leur réseau d’échanges est sans doute plus vaste qu’on l’imagine. Sont-ce déjà des Inuits ? En sont-ils les ascendants immédiats ? En tout cas, le monde inuit est en place. Leur expansion vers le sud a sans doute mis les Thuléens en contact avec les Vikings.
Lesquels avaient débarqué au Xe siècle, à la suite d’Erik le Rouge. L’Islande servit de tremplin. Et plusieurs facteurs sans doute favorisèrent l’opération : les règles de succession norvégiennes, l’amélioration des navires, l’optimum climatique médiéval. Les colons s’étaient installés au sud, dans le fjord de Tunulliarfik d’abord. Autour de l’an mil, toutes les terres habitables au sud-ouest du Groenland, ainsi que l’avait nommé Erik à des fins probablement publicitaires, étaient habitées. La colonie a pu compter quelques milliers de personnes, vivant surtout d’élevage et de chasse. Le christianisme vint avec elle : l’église de Gardhar / Igaliku sera épiscopale du XIIe au XIVe siècle. Au XIIIe, les rois de Norvège étendent leur suzeraineté au Groenland. Et instaurent un monopole commercial. Par contre l’Union de Kalmar de 1397, qui unit les pays scandinaves sous impulsion danoise, se désintéresse de la question. La colonie accuse le coup. Elle va s’étioler pour un faisceau de raisons encore en discussion. Les dernières tombes connues – cimetière d’Herjolfsnaes / Ikigaat – datent de la toute fin du XVe siècle. Comme les Paléo-Eskimos, les Vikings ont fait un tour et s’en sont allés. Pendant ces cinq cents années, des contacts avec les chasseurs du Dorset ou de Thulé n’ont pas manqué d’avoir lieu, mais ils sont mal documentés et il est difficile d’en préciser les contours.
Les Inuits, appelons-les ainsi désormais, se sont adaptés à la petite glaciation. À partir du XVIe siècle et jusqu’au XVIIIe, ils habitent seuls le Groenland. Quelques bateaux passent, sans insister. Néanmoins, en Europe, les choses évoluent. Dans le cadre du Danmark-Norge, qui a succédé à l’Union de Kalmar, Copenhague prend la main. Les Inuits l’ignorent, mais ces choses les concernent. Les rois danois ont deux préoccupations, le commerce et la foi luthérienne. En 1721, le pasteur norvégien Egede est envoyé vers cette terre dont on est sans nouvelles depuis plusieurs siècles. Christianisme et comptoirs sont à rétablir. Les marchands dano-norvégiens s’y attèlent. Les missionnaires aussi. Nuuk est fondée, sous le nom de Godthab. En 1776, l’administration de l’île est confiée à la Kongelige Gronlandske Handel. Les activités halieutiques prennent leur essor. L’apostolat mord lentement sur les traditions des Inuits du sud-ouest. En 1814, la paix de Kiel, entre l’Angleterre, la Suède et le Danemark, abandonne Islande, Féroé et Groenland au Danemark. La Norvège n’a pas voix au chapitre.
Le XIXe siècle voit augmenter la présence et l’activité danoises. Quelques groupes inuits immigrent du Canada au Groenland septentrional. Deux assemblées locales – nord et sud – sont créées. En 1867, le Danemark décline une offre américaine d’achat du Groenland et de l’Islande. À partir de 1905 et pendant trente ans, tensions avec la Norvège, qui conteste les conséquences de la paix de Kiel ; cela se résout au profit du Danemark. Les explorations de l’Américain Robert Peary réactivent les appétits US (que Copenhague pense combler en 1917 par la vente de ses possessions antillaises, depuis United States Virgin Islands). En 1912, un iceberg issu du fjord d’Illulissat est heurté par un paquebot : le Groenland a coulé le Titanic. Le royaume de Danemark reste à la marge de la 1ère Guerre mondiale.
La 2nde étant plus mondiale encore, il n’y a plus de marge. Le Groenland a une importance stratégique. Pour l’essentielle information météo, en particulier. Dans un contexte politique confus, les Américains installent des bases et des stations météo. Les Allemands tentent de prendre pied sur le littoral oriental. La Sirius Dog Sled Patrol repère les sites et les fait détruire par l’aviation. La guerre froide suit ; la valeur stratégique du territoire augmente. Le Danemark (qui, en 1946, a repoussé une nouvelle offre d’achat américaine) et les USA s’accordent pour pérenniser la base de Thulé, au sud de Qaanaaq. Les Inuits du secteur sont transférés. La question nucléaire s’invite au Groenland. Dans les années 50, le processus de décolonisation est enclenché : l’administration de la Kongelige Gronlandske Handel est révoquée ; le Groenland devient une province danoise (qui envoie deux députés élus au Folketing à Copenhague) ; le commerce est libéralisé. La société inuite s’adapte bon an mal an à cette nouvelle modernité.
L’autonomie du territoire dans le cadre du royaume de Danemark est acquise en 1979. Peu après, le Groenland quitte l’Union Européenne. Pourquoi ? La pêche sans doute (cependant, l’effondrement de la morue pendant la décennie suivante a fragilisé l’économie). Et d’éventuelles restrictions sur la chasse. Le pays se présente désormais comme nation inuite. Alors que la commission pour l’autodétermination propose de mettre la base de Thulé, en tant que centre international d’observation du trafic satellitaire, sous l’autorité des Nations Unies, les États-Unis souhaitent l’intégrer à leur bouclier anti-missiles. Dès son premier mandat, le président Donald Trump évoque dans cette perspective un éventuel achat du Groenland. Depuis 2020, la base de Thulé / Pituffik est placée sous le commandement de la United States Space Force.
Personnalités
Snaebjörn Galti, 910-978. Arriver le premier. Cela peut vous assurer l’immortalité. Voyez Gagarine. Cela peut aussi vous condamner à l’oubli, ou presque. Ainsi Snaebjörn Galti, premier Européen à toucher intentionnellement le Groenland. Et tué peu après par un compagnon de voyage. Jusqu’à la saga consacrée à son entreprise qui est perdue. Il fallait s’appeler Erik le Rouge, partir quelques années plus tard, aborder au sud plutôt qu’à l’est, pour que ça marche. D’ailleurs, la Saga d’Erik le Rouge a été conservée.
Minik, 1890-1918. Triste histoire que celle de Minik. En 1897, il fut, avec sa famille inuite, emmené à New York par l’explorateur Robert Peary. L’anthropologue Franz Boas se penche sur eux ; et le public. Sans discrétion. La tuberculose prend le relais. Minik en réchappe. Il reçoit une éducation à l’américaine. Rentre au Groenland. Déphasé. Devient guide. Retourne aux États-Unis. Et meurt de la grippe. Cette vie ballottée entre deux mondes est emblématique d’un certain statut d’indigène.
Aleqa Hammond, née en 1965. Cette dame de Narsaq a longtemps travaillé pour le tourisme groenlandais. Elle est présidente du parti social-démocrate Siumut. Et, après avoir occupé diverses fonctions ministérielles, elle devient la première femme premier ministre du territoire, en 2013. Avec l’intention de mener celui-ci à une pleine indépendance. Un scandale financier la contraint de démissionner. Elle n’en reste pas moins un poids lourd de la politique de son pays.
Hans Egede, 1686-1758. Lorsqu’Hans, alors missionnaire luthérien aux Féroé, entend parler du Groenland et de sa vieille colonie norvégienne, il en conclut que les colons sont soit restés catholiques, soit retournés au paganisme. Dans les deux cas, il faut faire quelque chose. Il part. Et trouve des Inuits. Il lance la seconde colonisation européenne de l’île. Fonde la future Nuuk. Apprend le groenlandais et entreprend de convertir les naturels. Il publie Det gamle Gronlands nye Perlustration en 1729. Il est l’initiateur du Groenland moderne.
Knud Johan Victor Rasmussen, 1879-1933. Il est né à Ilulissat, de père danois et de mère inuite. Une culture équilibrée, intellectuelle et pratique de l’Arctique en a fait le fondateur des études eskimo contemporaines. Parmi ses voyages, le plus fameux lui a permis de parcourir le passage du Nord-Ouest, du Groenland au détroit de Béring, en 1921 / 24. Des deux compagnons inuits de l’expédition, l’un était une femme, Arnarulunnguaq, qui devait se révéler une assistante ethnographe de premier ordre.
Jean Malaurie, 1922-2024, illustre la fécondité de la recherche polaire française (à laquelle appartient aussi Paul-Émile Victor, 1907-1995, par exemple) : de la géomorphologie à l’ethnologie, il a travaillé à éclairer la complexité des réalités groenlandaises. On lui doit – dans la collection Terre humaine, qu’il dirigeait – un livre essentiel sur les Inuits du Groenland, Les derniers rois de Thulé, 1955. Son engagement pour les droits des peuples arctiques ne s’est jamais démenti.
Marie Athalie Qituraq Kleist, Maaliaaraq, 1917-2012. Élève puis étudiante brillante, Maaliaaraq fut l’une des premières Groenlandaises à recevoir une éducation supérieure validée au Danemark. Elle fut enseignante, ethnologue, archéologue et, surtout, écrivain. Elle publie contes et chansons, qu’elle illustre, et le premier roman d’une Groenlandaise, Rencontre dans le bus, en 1981. Lequel se penche sur le sort parfois difficile des femmes engagées dans des unions dano-inuites.
Nive Nielsen, née en 1979. Actrice – The New World de Terrence Malick, notamment – et musicienne, Nive Nielsen est une artiste groenlandaise dont la banquise n’est pas le seul horizon. Elle met de l'indie folk et du folk-rock dans son background groenlandais et on trouve Patrick Carney des Black Keys sur son premier album. Avec ses Deer Children, elle tourne en Europe, en Amérique et au Groenland, pour autant qu’on puisse y tourner.
Martha Biilmann, 1921-2008, nous permet d’évoquer la pelleterie. Chez nous, cet artisanat des cuirs et fourrures est résiduel, mais au Groenland, il est essentiel. D’ailleurs, les talents d’Arnarulunnguaq dans ce domaine ont bien aidé Knud Rasmussen. Martha Biilmann a mis au point une technique de conservation des peaux de phoque par salage qui a fait sa renommée. Elle a été conseillère gouvernementale pour la tannerie. Une sorte de trésor national, en somme.
Qupanuk Olsen, née en 1985 à Qaqortoq, est une youtubeuse groenlandaise (éducation et traditions nationales). Elle est aussi ingénieur des mines et membre de l’Inartsisartut, le Parlement. Engagée pour l’indépendance de son pays, elle mise, comme beaucoup, sur le sous-sol pour lui assurer une subsistance.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Lorsqu’on vous propose de partager du phoque, on vous fait honneur. N’en déplaise à une certaine sensibilité, cette chasse ancestrale est encore fort répandue. Souvenez-vous que le Groenland est très impropre à l’agriculture. Et que la seule façon de consommer des protéines, sans dépendre d’importations, c’est de chasser. La plupart des Groenlandais possèdent encore un traîneau et des chiens pour filer sur la banquise. En dépit de la sédentarisation, ce peuple de nomades a gardé intact son penchant pour la pleine nature. Il est à relever, au risque d’insister, que la chasse a une place centrale dans la culture groenlandaise. Le ministre H. Rasmussen notait : Adaptés aux conditions extrêmes de la vie dans l’Arctique depuis au moins quatre mille ans, les Inuits ne sont même plus des chasseurs-cueilleurs. Les Inuits sont des chasseurs, purement et simplement. Les Groenlandais jouissent donc de droits de chasse particuliers et le gibier est un pilier de l’hospitalité locale.
Cuisine
Des siècles de chasse et de cueillette imposées par les circonstances ont laissé une empreinte profonde dans la cuisine groenlandaise. Beaucoup de viande ; baies et feuilles occasionnelles. La première est terre air mer : renne et bœuf musqué sont des gibiers, le mouton est issu d’un petit élevage ; eider, lagopède, guillemots, mergules sont appréciés ; mais aucun autant que le phoque, le morse ou les balénidés (dont la chasse est strictement encadrée). Les poissons sont au menu ; d’eau salée comme le flétan ou la morue, d’eau douce comme l’omble chevalier. Et les fruits de mer, qui sont succulents. En été et à l’automne, la cueillette fournit des baies : myrtilles, airelles, plaquebière, camarine noire. Et des champignons. Des feuilles aussi ; oseille, pissenlit, orpin rose (qui est à la limite de la cuisine et de la pharmacopée). Les algues ont leur place à table. Ainsi que navets et pommes de terre. Certains plats traditionnels sont abordables sans appréhension, comme la soupe suaasat. Elle est faite d’oignon, de pommes de terre et d’orge, auxquels on ajoute une viande, phoque surtout, mais aussi baleine, renne ou oiseaux de mer. Kiviak, par contre, n’est pas sans risque de botulisme. Il s’agit de mergules ou de guillemots fermentés dans une carcasse de phoque. Cette préparation qui permettait de passer l’hiver illustre un mode de conservation des aliments : la fermentation. Ainsi aussi misirak, graisse de phoque ou de bélouga fermentée. Igunak est une procédure sophistiquée, qui combine fermentation et congélation. On enterre une viande – morse, par exemple, ou renne – à l’automne dans une terre humide où elle commence à fermenter ; puis contenant et contenu gèlent. Il faut que le froid soit à l’heure. Tout cela se pratique encore, mais les importations procurent variété des ingrédients et des méthodes. Le bœuf musqué se sert désormais en burger. Par ailleurs, le Groenland est le fer de lance d’une nouvelle cuisine arctique, qui combine tradition culinaire et gastronomie contemporaine. Pas de dessert ? Dans le sud-ouest, on fait de délicieuses tartes à la rhubarbe.
Street food : le capelan, Mallotus villosus, est un petit poisson que l’on ramasse sur les plages en mai et juin. Une fois séché, il fait un en-cas dont les Groenlandais raffolent. Le poisson sur la pierre n’est pas particulièrement street, mais il relève de la cuisine d’occasion. Vous avez attrapé un poisson ; vous remplissez votre marmite – vous ne sortez pas sans marmite, bien entendu – d’eau du fjord, dans laquelle vous cuisez sur un feu le poisson en morceaux. Pendant ce temps, vous trouvez une pierre plate. La cuisson terminée, versez une partie du bouillon sur la pierre pour la nettoyer et déposez dessus le poisson. On mange avec les doigts, ou la coquille de quelque coquillage de rencontre.
Boissons
Les glaciers fournissent l’une des eaux les plus pures au monde. Certains s’en sont avisé et brassent avec de la bière. Néanmoins, le breuvage auquel les Groenlandais tiennent le plus est sans doute le café. Qu’ils additionnent à l’occasion de whisky et de crème fouettée.