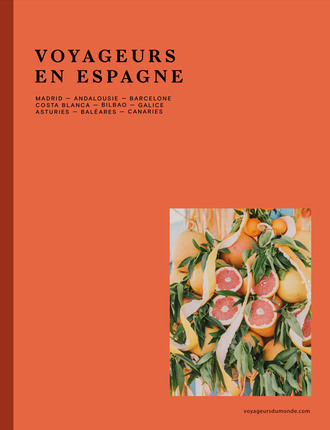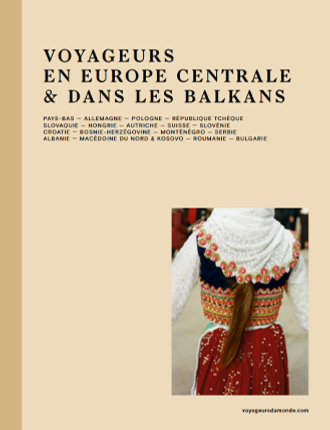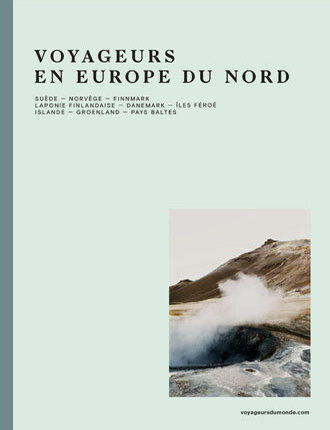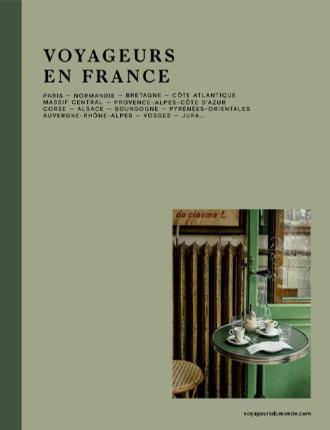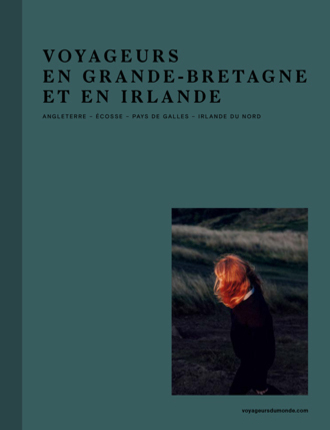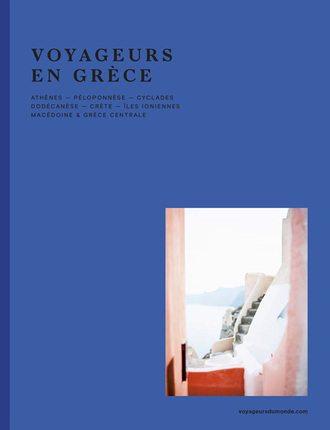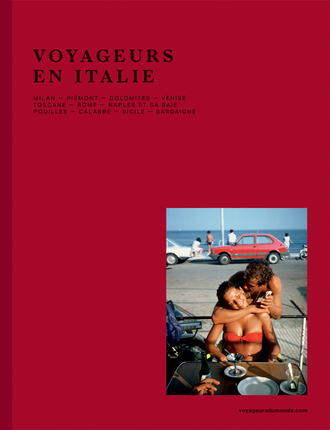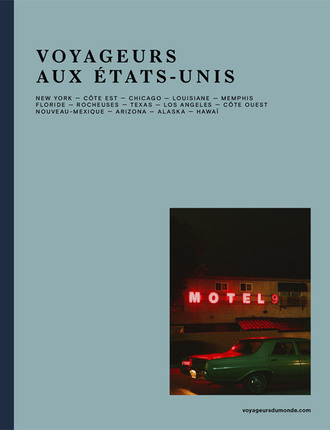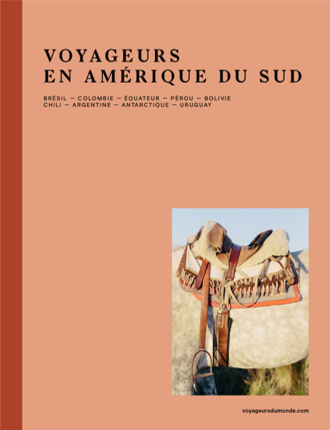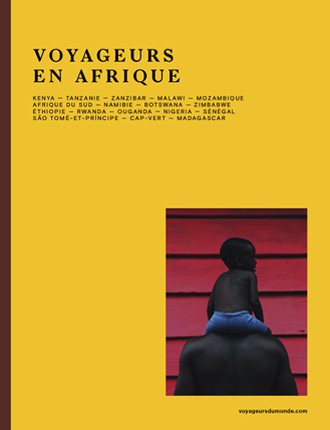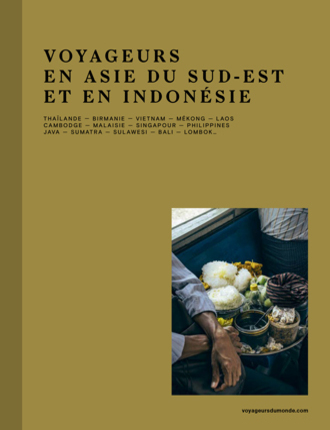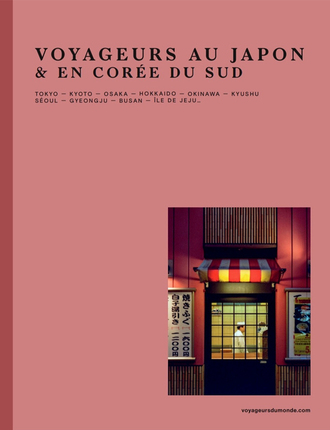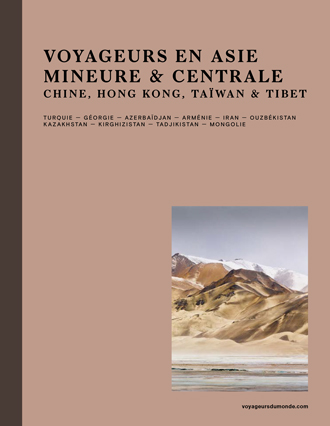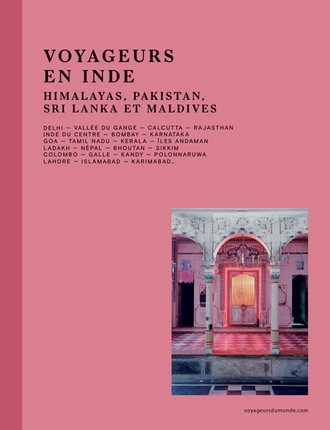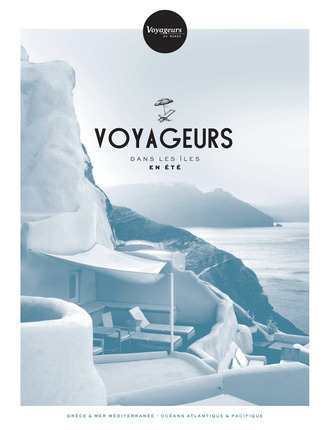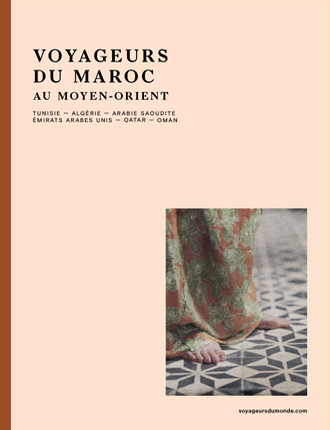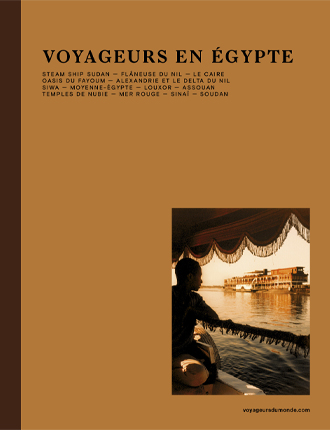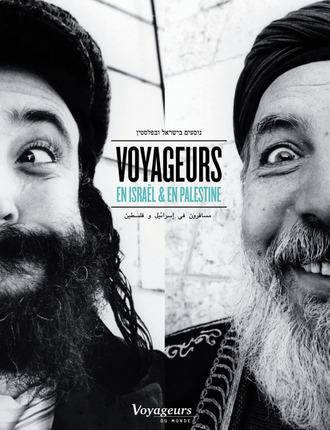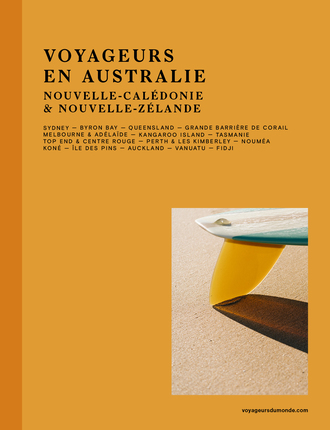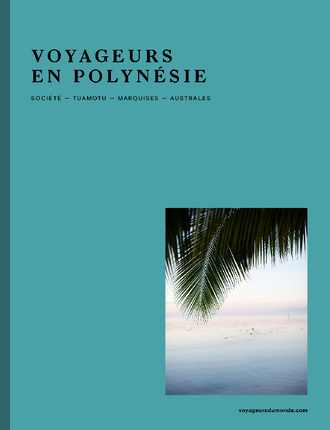Population
19 856 577, en 2025.
Langue officielle
L’espagnol.
Langues parlées
L’espanol guatemalteco est parlé par environ 70% des Guatémaltèques. Les différences avec l’espagnol standard sont surtout lexicales. 21 langues mayas sont reconnues par les autorités. Pour de nombreux indiens elles sont leur langue maternelle et celle qu’ils parlent au niveau communautaire ; l’espagnol n’étant pratiqué – éventuellement – qu’en seconde langue. Éventuellement car bien des personnes ne sont pas bilingues. Les langues indiennes les plus utilisées sont le quiché, le q’eqchi’, la mam et le kaqchikel. Sous la bannière de la Nueva Escuela Bilingüe Intercultural, des programmes d’éducation bilingues ont été mis en place (que certains militants regardent comme une tentative d’espagnolisation douce).
Peuples
Le recensement de 2002 distingue quatre composants du peuple guatémaltèque : les Ladinos, descendants des colons espagnols (essentiellement des métis hispanophones), 60% de la population ; les Mayas (différentes communautés de langue maya : Quiché, Q’eqchi’, Mam, Kaqchikel, etc.), 39,6% ; les Xinca (une population indienne non maya, dont la langue est probablement éteinte), 0,14% ; les Garifuna (descendants d’esclaves africains et d’indiens caraïbes), 0,04%. Dans les montagnes de l’ouest, les indiens sont jusqu’à 95% des habitants ; population globalement pauvre et marginalisée.
Religions
90% des Guatémaltèques sont chrétiens. De ce point de vue, la situation est stable. En revanche, une recomposition confessionnelle est en cours : l’église catholique – longtemps hégémonique – ne rassemble plus qu’environ la moitié des fidèles ; le protestantisme évangélique ayant lui le vent en poupe. Certaines estimations situent celui-ci – pentecôtiste surtout – à hauteur de 40%. Les anciennes croyances indiennes n’ont pratiquement pas survécu de façon autonome, mais elles se sont glissées dans les bagages du catholicisme s’assurant ainsi une forme de perpétuation. Le culte du saint ambigu Maximon, qui associe les figures du conquistador Pedro de Alvarado, de Judas Iscariote, de saint Pierre et de l’esprit maya Mam, peut illustrer ce syncrétisme.
Fête nationale
15 septembre : Indépendance, 1821.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
En mars ou avril : Pâques.
1er mai : fête du travail.
10 mai : fête des mères.
30 juin : jour des forces armées.
15 août : Assomption.
15 septembre : fête nationale.
20 octobre : jour de la Révolution, 1944.
1er novembre : Toussaint.
25 décembre : Noël.
Ce sont les jours fériés. Du Dia del Cristo Negro de Esquipulas (15 janvier) au Dia de la Immaculada Concepcion (8 décembre), les jours de fête sont beaucoup plus nombreux.
Politique
La Republica de Guatemala est une république présidentielle. Le président est élu pour 4 ans – mandat non renouvelable – au suffrage universel direct. Il est à la fois chef de l’État et du gouvernement, assumant donc la totalité du pouvoir exécutif. Le législatif est exercé par un parlement monocaméral, le Congreso de la Republica. Lequel est à 160 députés élus pour 4 ans – circonscriptions régionales et listes nationales. La Corte de Constitucionalidad checke la constitutionnalité des lois. Et la Corte Suprema de Justicia coiffe le système judiciaire. Le pays est divisé en 22 départements, ayant chacun à sa direction un gouverneur départemental nommé par le président.
Histoire
La civilisation maya – le terme apparait au début de la période coloniale pour désigner à la fois une langue et un territoire ; il serait dérivé du toponyme Mayapan (cité du nord Yucatán) – passe largement les frontières de l’actuel Guatemala. Les commencements sont lointains et obscurs, mais l’époque classique est assez bien circonscrite, entre 250 et 900 de notre ère. Tikal, la grande cité du Petén, domine jusqu’au VIe siècle. Elle est alors soumise par Calakmul, qui impose son hégémonie pour trois cents ans. La cité-État semble avoir été le cadre de l’organisation sociopolitique. L’archétype architectural est la pyramide à degrés. La religion articulait calendrier et sacrifices sanglants, commentaires et effusions prophétiques, régularité et évènements. Les prêtres ont une position éminente, mais aussi les nobles, les guerriers, certains marchands. Le roi est l’expression charismatique de tout cela. Le peuple est attaché à la terre. Il cultive le maïs, les haricots et les courges. Élève des dindes et des chiens. La forte hiérarchie de cette société est corrigée par la prégnance de liens familiaux qui associent des membres de différentes classes. Hégémonie, sujétion, tribut : la guerre était une pratique ordinaire des cités-États. Néanmoins, un certain équilibre règne, jusqu’à ce que – ainsi les archéologues le constatent-ils entre 800 et 900 – les constructions cessent progressivement dans les basses terres yucatèques, le système politique s’effondre, les cités se dépeuplent. À la clé, la parcellisation de l’espace, les déplacements de populations et l’apparition de nouvelles entités dans les hautes terres. L’influence mexicaine – politique, religieuse, culturelle – est avérée. Les Quiché, les Kaqchikel, les Mam, les Itza s’affirment, qui disent tenir leur légitimité des Toltèques. En 1521, les Espagnols, ayant défait les Aztèques, se tournent vers le sud. Profitant des divisions du monde maya (et de spéculations apocalyptiques locales), Pedro de Alvarado, un temps allié aux Kaqchikel, prend rapidement l’avantage en territoire guatémaltèque. Les derniers bastions mayas, sur le Petén Itza, ne seront toutefois réduits qu’en 1697. La variole seconde efficacement les conquistadores.
En 1609, la Capitania general de Guatemala est une partie constitutive de la Nouvelle-Espagne. La première capitale régionale, Santiago de los Caballeros (aujourd’hui Ciudad Vieja), détruite par un séisme en 1542, a été reconstruite, c’est Guatemala (aujourd’hui Antigua). La terre continue de trembler et la ville de crouler. Nouveau déplacement et nouvelle fondation : Ciudad de Guatemala, 1776. La Capitainerie générale administre un vaste territoire allant du Chiapas au Costa Rica. On y cultive la canne à sucre et le cacao ; l’indigo et les cochenilles permettent de produire des teintures ; les bois précieux abondent, qui partent pour l’Europe dans les cales des galions. En outre, la position du pays offre une route d’appoint au Galeon de Manila (qui assure la partie Pacifique du transport vers l’Espagne des marchandises de la Chine). Les missionnaires qui évangélisent le Guatemala mettent au service d’un apostolat de combat une connaissance précise des langues et de la culture mayas. Ainsi qu’en témoigne par exemple la Relacion de las cosas de Yucatan du franciscain Diego de Landa, vers 1566. L’Église est le pilier de la société coloniale. Comme au Mexique, une certaine créolisation se fait ; néanmoins, au Guatemala, le monde indien reste plus compact et étanche. En fait, la colonie tire à hue et à dia ; indiens, colons et religieux visant des pipes différentes. Les accords sont minés d’arrière-pensées, d’intentions secondes. Ces déséquilibres vont avoir une longue postérité. Les formules administratives varient avec les impératifs des temps.
Au début du XIXe siècle, la Capitainerie est divisée en quinze provinces. En 1812, les Cortès de Cadix donnent une constitution libérale à l’Espagne. Deux ans plus tard, le retour de l’absolutisme avec Ferdinand VII déçoit en Amérique. Les libéraux s’agitent. On ne négocie plus. On s’arme. L’Espagne a perdu la main. Le 15 septembre 1821, l’indépendance est proclamée. Après un bref intermède mexicain, les anciens territoires de la Capitainerie générale forment les Provinces unies d’Amérique centrale. La guerre civile – 1838-1840 – met fin à l’expérience. Le Salvador se déclare indépendant en 1841 ; dès lors, le Guatemala prend son destin à bras le corps dans ses frontières actuelles. Le personnage-clé de la période est Rafael Carrera, chef rebelle puis président, de 1844 à sa mort en 1865. C’est un zambo, métisse indien / africain. Illettré mais charismatique et doué de sens politique, porté par les grandes familles, il donne à son pays un ascendant régional. La situation du Belize est précisée de façon pragmatique avec la Couronne britannique. À partir des années 1870, le Guatemala se modernise sous régime dictatorial. Laquelle dictature se nuance de libéralisme sous Justo Rufino Barrios : éducation primaire laïque, expropriation des biens de l’Église. On voit débarquer la Boston Fruit Company – future United Fruit Company – qui va régner sur l’économie centraméricaine pendant de longues décennies. Le café amorce son ascension.
Au XXe siècle, les dictateurs succèdent aux dictateurs. Lesquels ne peuvent rien refuser aux investisseurs nord-américains. La situation des indiens (et celle de nombreux petits agriculteurs) se dégrade. De 1944 à 1954, un « créneau démocratique » est ouvert, par un nouveau coup d’État. Les présidents Juan José Arevalo et Jacobo Arbenz Guzman donnent de l’air et une législation plus favorable à la petite bourgeoisie, aux ouvriers, aux paysans. On marque aux indiens une nouvelle considération. Arbenz engage la réforme agraire. Les grands propriétaires sont imposés. La United Fruit Company doit céder des terres aux paysans. Crime de lèse-majesté pour les États-Unis. Et maccarthisme aidant, on instrumentalise la guerre froide contre le président guatémaltèque. En 1954, l’opération PBSUCCESS, pilotée par la CIA, remet le pays dans le droit chemin et l’UFC en possession de ses possessions. En avant pour trente-six ans de guerre civile, 1960-1996. Des mouvements de guérilla révolutionnaires s’implantent dans les campagnes : Movimiento Reolucionario 13 Noviembre, Fuerzas Armadas Rebeldes, Ejército Guerillero de los Pobres, Organizacion del Pueblo en Armas. Le gouvernement leur oppose l’armée, les Patrullas de Autodefensa Civil, les Kaibiles, unité spéciale anti-insurrection. La présidence d’Efrain Rios Montt, 1982-1983, est particulièrement sauvage. Son successeur, le général Oscar Umberto Mejia Victores, permet toutefois un retour à la légalité démocratique. En 1985, une nouvelle constitution voit le jour ; un président civil est élu l’année suivante. Les conditions économiques, politiques et sociales de la transition sont acrobatiques mais, peu à peu, malgré de vives tensions (que l’église catholique s’efforce de réduire), les militaires regagnent leurs casernes et les institutions peuvent fonctionner. Le 29 décembre 1996, la paix est signée entre le président Alvaro Arzu Irigoyen et l’URNG – Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – qui regroupe les mouvements insurrectionnels de gauche. Bien entendu, on ne sort pas comme ça d’une aussi longue guerre civile, mais cet accord sert de base au pacte national qui tend désormais à assurer la stabilité politique du pays.
Les dernières décennies ont vu le Guatemala clarifier sa situation vis-à-vis des autres pays d’Amérique centrale. Entretenir et aménager ses liens avec les États-Unis. L’UFC, devenue Chiquita Brands International, se lance dans l’agriculture durable en collaboration avec Rainforest Alliance. Ce qui a des implications sociales. Naturellement, les choses ne sont pas roses pour verdir un peu. Néanmoins, la donne a changé. À l’intérieur, ce sont les remous liés à la normalisation politique et le processus de réconciliation national qui ont focalisé l’attention des gouvernements. Les inégalités économiques et sociales restent considérables et réclament, sinon une utopique solution immédiate, du moins des pas décidés dans la bonne direction.
Personnalités
Pedro de San José de Betancur, 1626-1667. Santo Hermano Pedro est né à Tenerife, puis il est parti aux Amériques. Entré chez les franciscains, il rejoint le Guatemala. Où il fonde l’Ordo Fratrum Bethlemitarum, premier ordre américain. Il se consacre aux pauvres et aux malades, aux pénitents du purgatoire et à l’Immaculée Conception. Il est inhumé dans l’église San Francisco d’Antigua Guatemala. Canonisé en 2002. Premier saint du Guatemala et précurseur d’un Stanley Rother, assassiné par des paramilitaires en 1981.
Juana de Maldonado y Paz, Juana de la Concepcion, 1598-1668. On a douté de l’existence de cette religieuse de l’Immaculée Conception de Santiago de los Caballeros, mais il est désormais établi qu’elle ne fut pas une pure création littéraire du dominicain anglais Thomas Gage. Elle vécut sa vie de femme de talent – écrivain et musicienne – où il était possible de le faire alors : au couvent. Ces instituts étant au XVIIe siècle des centres à la fois religieux, intellectuels et artistiques.
Miguel Ángel Asturias, 1899-1974. C’est l’une des célébrités du Père Lachaise, division 10 (en 2024, le transfert au Guatemala a été annoncé). Juriste, diplomate, écrivain, un temps proche des surréalistes, il a reçu le prix Nobel de littérature en 1967. Son œuvre fait un pont anthropologique entre la modernité européenne et l’ancienne culture maya. Du Problème social de l’indien, sa thèse de 1923, au testamentaire Vendredi des douleurs de 1972, elle reflète les ombres et les lumières du Guatemala.
Margarita Carrera, 1929-2018. Elle fut une femme de premières : 1ère femme à recevoir un parchemin en littérature de l’université San Carlos ; 1ère femme aussi à entrer à l’Académie guatémaltèque du langage. Résultats remarquables quand on sait que ce parcours avait commencé en cours du soir. Ensuite, une vie intellectuelle diverse dans ses moyens, mais d’une constante unité d’exigence. En 1996, le prix Miguel Ángel Asturias lui est décerné.
Rigoberta Menchu, née en 1959, est une indienne Quiché. Un long combat pour la reconnaissance des droits des indiens lui a valu le prix Nobel de la paix en 1992. Elle a fait le récit de sa vie et de ses engagements dans un livre célèbre, coécrit avec l’historienne Elizabeth Burgos : Moi, Rigoberta Menchu, 1983. Et a participé à la préparation de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007.
Paula Nicho Cumez, née en 1955. Cette peintre serait la principale protagoniste d’un surréalisme Kaqchikel. Les critiques la rapprochent parfois d’une certaine expression naïve. C’est sans doute appliquer à ces œuvres des catégories dont elles ne relèvent pas. Car il y a quelque chose d’irréductible dans le chemin que la culture maya s’ouvre ici à travers la peinture dans son acception européenne. Et qui a sollicité l’attention des chercheurs autant que des amateurs.
Carlos Mérida, 1891-1984. Il est de façon emblématique un peintre de trajets. Ses voyages, ses contacts, les techniques et les supports qu’il a utilisés, ses fidélités témoignent avec éloquence des déplacements qui s’imposaient aux artistes centraméricains de sa génération. D’une approche narrative proche des fresquistes mexicains à l’abstraction, de la toile à la mosaïque, du format de salon au monumental, il n’a eu de cesse d’ajuster ses moyens aux fins du travail pictural.
Sara Curruchich, née en 1993. En termes d’engagement, elle descendrait de Rigoberta Menchu, ou en poursuit la bataille avec des moyens nouveaux. Car devenir une musicienne Kaqchikel ne va pas de soi et la situation symbolise efficacement celle des femmes indiennes. Cela étant, Sara Curruchich – guitariste et joueuse de marimba, chanteuse, compositrice – n’a pas le militantisme morose et sa musique provoque à rythmes démultipliés plaisir et réflexion.
José Eulalio Samayoa, 1780-1866. L’œuvre de Samayoa est inscrite dans l’histoire du pays. Formé dans le cadre de la musique religieuse espagnole, il a fondé en 1813 la Société philharmonique du Guatemala. Ce qui n’était pas sortir du cadre – puisqu’elle était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus – mais regarder les choses sous un autre angle. Symphonique. Il a aussi remplacé de trop conventionnels motifs européens par des sones issus de la tradition indienne. L’un des fondateurs de la musique classique d’Amérique centrale.
À la United Fruit Company, créée en 1899, on doit ce que la banane évoque de désagréable : la république bananière. Cette société nord-américaine, symbole de la collusion entre économie et coups tordus, était particulièrement implantée au Guatemala, qu’elle avait mis en coupe réglée dans les années 1960 et 70. Elle a eu les honneurs d’un poème de Pablo Neruda dans Canto general, 1950.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Dans les échanges, le vouvoiement est de rigueur.
Cuisine
La cuisine du Guatemala est héritière de la table maya. Le maïs, les haricots, les courges, le piment en constituent encore la base. Le cacao peut – comme un luxe autrefois, plus démocratiquement aujourd’hui – leur être associé. Des fruits également : tomate, avocat, ananas, sapotille, canistel, sapote, etc. Dans les caravelles espagnoles sont arrivés veaux, vaches, cochons, couvées et le blé, l’orge, le riz. Des fruits nouveaux : raisin, pomme, poire, orange, citron. L’hybridation a donné la cuisine guatémaltèque moderne. Quelques plats sont officiellement intégrés au patrimoine national. Ainsi, pepian, un mijoté (épaissi aux graines de courge) de bœuf ou de poulet, tomates, tomatilles et piment. Kak’ik est une soupe dans laquelle entrent de la dinde, ail, oignon, menthe, panicaut fétide, baies de roucou. La recette de la sauce mole peut s’enrichir extraordinairement, mais l’ingrédient distinctif en est le cacao. Il y a aussi le jocon, une autre sauce : tomatille, tomate verte, oignon, piment, coriandre. Le poulet et le riz en ont les honneurs. Certains plats sont plus particulièrement liés à une occasion. Ainsi le fiambre est-il servi pour la Toussaint et le Dia de Muertos. C’est une salade composée dont chaque famille a une recette.
On pourrait évoquer une ribambelle de plats, mais les tamales sont caractéristiques de la cuisine guatémaltèque. Les variantes ne manquent pas, cependant la formule demeure : tortilla fine farcie et cuite enveloppée dans une feuille de bananier ou de cachibou. La première est normalement de farine de maïs ; diverses viandes, divers légumes, des fruits, entrent dans la farce en proportions diverses. Selon, les tamales seront negros, colorados, de elote (de maïs doux), tamalitos (de format plus petit que le tamal ordinaire), etc. Le chuchito est un tamalito en papillote de spathe de maïs. Le riz a pris une certaine importance dans l’alimentation et arroz con frijoles, le riz aux haricots, peut passer pour un classique. Un dessert ? Les rellenitos de platano, beignets de banane et haricots sucrés, ou les galettes de manioc.
Street food : chicharrones (couenne de cochon) et carnitas (poitrine) sont des en-cas très répandus et appréciés. Guatemala City a son interprétation du hot dog : shuco. Dans un bun toasté, on dépose guacamole, mayonnaise, ketchup, moutarde et chou émincé, plus saucisse et viandes. La composition varie, mais un bon shuco est toujours un attentat contre la diététique. Les mixtas Frankfurt sont une autre adaptation du hot dog : le bun est replacé par une tortilla et la saucisse nappée de guacamole (en fait, on doit aussi regarder la chose à partir des mixtas guatémaltèques, c’est alors une adoption). Elotes locos sont des épis de maïs doux, grillés et servis enduits de mayonnaise, de fromage gratté, d’un mélange d’épices pimenté et aspergés d’un trait de citron. Quant aux bunuelos, ce sont des beignets enrobés de sucre et de cannelle. Croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur. Au mois de mai, apparaissent sur les marchés du centre d’assez grandes fourmis, les zompopos de mayo. L’espèce – Atta laevigata – est comestible et, grillée, elle est servie avec sel, piment, citron. Un encouragement à l’entomophagie.
Boissons
L’eau du robinet est impropre à la consommation. On boit donc de l’eau minérale capsulée : agua pura, eau plate ; agua mineral, eau gazeuse. Ou des sodas. La bière est une autre solution, à laquelle les Guatémaltèques recourent volontiers. Gallo est la blonde standard. Les jus de fruit sont délicieux (s’ils sont coupés d’eau, leur innocuité est fonction de celle de l’eau). Le café consommé sur place est communément instantané, additionné de lait en poudre et de sucre : exportation du bon grain. Producteur important de canne à sucre, le pays ne pouvait manquer de distiller et d’élever du rhum. Le vieillissement de l’alcool en altitude lui donne un style particulier. Dont les amateurs font grand cas. De la canne, on tire aussi le guaro, plus sucré et doux que le rhum. Quant à atol de elote, il est fait à partir de maïs doux et servi chaud, parfumé à la cannelle, à la vanille, à la goyave ou au chocolat (et à autre chose encore).